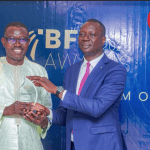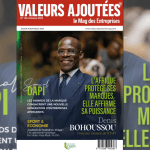Un mardi à minuit, l’Afrique commerciale a changé de visage.
Le 30 septembre 2025 marque la fin officielle de l’AGOA (African Growth and Opportunity Act), cet accord qui offrait depuis un quart de siècle un accès préférentiel au marché américain à 35 pays d’Afrique subsaharienne.
Derrière la sobriété administrative de cette échéance se cache un basculement silencieux : la disparition d’un pilier du commerce Afrique–États-Unis, et la naissance d’un nouvel équilibre mondial dont les contours restent flous.
- L’ombre silencieuse des nouveaux tarifs “Liberation Day”

L’un des aspects les plus explosifs, mais les moins discutés, réside dans l’instauration des tarifs “Liberation Day”, des surtaxes spécifiques mises en place par Washington dès 2025.
Ces taxes, cumulées aux droits de douane classiques, rendent instantanément non compétitifs certains produits africains naguère exonérés.
Selon Ecofin Agency, les premières simulations montrent des hausses de tarifs globales de 25 à 40 % sur des segments clés comme le textile, le cuir et l’agroalimentaire transformé.
Autrement dit, un T-shirt camerounais ou éthiopien vendu 10 dollars aux États-Unis coûtera demain 13 à 14 dollars à l’importateur américain.
Une différence qui, dans un marché dominé par la compétitivité prix, équivaut à une disparition pure et simple.
L’UNCTAD (CNUCED) confirme : la fin de l’AGOA ne sera pas une simple question de douane, mais un choc de viabilité économique pour des milliers de petites industries africaines dont la structure de coûts repose sur les exonérations américaines.
- Les “gagnants” invisibles : quand la géographie devient stratégie
Si le continent pleure la fin d’un privilège commercial, certains États entrevoient dans cette rupture une opportunité stratégique.
 Les exportateurs de minerais et métaux stratégiques – cobalt, manganèse, cuivre, lithium – verront peu d’impact : ces produits restent protégés par des accords sectoriels ou des exemptions spécifiques.
Les exportateurs de minerais et métaux stratégiques – cobalt, manganèse, cuivre, lithium – verront peu d’impact : ces produits restent protégés par des accords sectoriels ou des exemptions spécifiques.
Les économies mixtes comme l’Afrique du Sud, disposant d’un tissu industriel solide, peuvent absorber le choc et réorienter leurs exportations vers l’Asie.
Et la Chine, selon le think tank FDD.org, s’apprête déjà à “remplir le vide laissé par Washington” en offrant à plusieurs pays africains des accès préférentiels à son propre marché.
Ce réalignement annonce un scénario inédit :
les pays africains capables d’intégrer rapidement les chaînes sino-africaines de production et de distribution seront les nouveaux pôles d’attraction du commerce mondial.
Pour les autres, le risque est clair : marginalisation et perte de souveraineté industrielle.
- L’effet domino logistique et financier
Au-delà des droits de douane, la fin de l’AGOA provoque un choc systémique.
Les opérateurs logistiques africains font déjà face à une hausse des coûts de fret et d’assurance.
Les délais de dédouanement vers les ports américains s’allongent.
Les contrats d’assurance-crédit se renégocient à la hausse.
Pour une PME camerounaise exportant des vêtements, le simple coût de transit pourrait augmenter de 20 %.
Les banques, quant à elles, durcissent leurs conditions de financement export : davantage de garanties, des marges réduites, des délais plus courts.
Les exportateurs fragiles seront les premiers exclus du circuit.
Enfin, les chaînes régionales intégrées – où un pays produit les tissus, un autre assemble, et un troisième exporte – pourraient s’effondrer.
L’AGOA garantissait un marché de destination commun.
Sans lui, les flux interafricains risquent de s’assécher.
- Le retour de manivelle géopolitique : la Chine avance ses pions

L’AGOA n’était pas qu’un outil économique : c’était un levier d’influence américaine.
Sa disparition laisse un vide que la Chine, l’Inde et les pays du Golfe se disputent déjà.
Pékin a étendu en 2025 sa politique d’exonération tarifaire à plus de trente pays africains.
Ses zones franches – de Lekki (Nigeria) à Suez (Égypte) – deviennent des alternatives stratégiques pour les industriels africains privés du marché américain.
Mais le risque est double :
une recolonisation économique subtile, où l’Afrique échange un accès douanier contre des concessions minières, et une dépendance renouvelée vis-à-vis d’un seul partenaire dominant.
L’absence d’un “plan B” continental crédible fragilise la position africaine dans les négociations commerciales à venir.
L’AfCFTA (Zone de libre-échange africaine) offre une issue, mais son implémentation reste lente et inégale.
- Les ruptures invisibles à venir
Derrière les effets immédiats, plusieurs ruptures profondes se profilent.
Effet d’éviction des PME locales.
Les grandes firmes logistiques et trading houses internationales pourraient s’imposer comme intermédiaires exclusifs entre l’Afrique et les nouveaux marchés, captant ainsi la valeur ajoutée au détriment des producteurs.
Révolution normative.
Les marchés de substitution – Europe, Asie, Amérique latine – imposent désormais des critères sévères : traçabilité, durabilité, empreinte carbone.
Beaucoup d’entreprises africaines, non préparées, risquent d’être exclues.
Exode industriel.
Des unités textiles ou manufacturières envisagent de relocaliser vers l’Asie du Sud pour maintenir l’accès au marché américain.
Une hémorragie silencieuse de savoir-faire et d’emplois.
Fracture régionale.
Les pays disposant d’infrastructures modernes (ports, énergie, numérique) continueront à attirer les investissements.
Les autres pourraient retomber dans un cycle d’exportation brute, sans transformation locale.
- Les pistes de résilience – ou comment rebondir
Malgré tout, la fin de l’AGOA peut devenir un catalyseur si les acteurs africains adoptent une approche proactive.
Créer des hubs d’assemblage pour tiers.
Offrir des services d’assemblage à des marques internationales permet de maintenir la production locale sans être exposé directement aux tarifs américains.
Fonder des clusters export sécurisés.
Mutualiser la logistique, les garanties bancaires et les labels entre PME régionales.
Un modèle de “coopétition” qui réduit les coûts et augmente la visibilité à l’international.
Développer des fonds de stabilisation sectoriels.
Inspirés des modèles asiatiques, ces fonds serviraient de filet de sécurité en cas de rupture de commandes ou de chocs tarifaires.
Redéployer vers les marchés émergents secondaires.
L’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud offrent des débouchés nouveaux, souvent moins saturés.
Les entreprises africaines doivent s’y positionner avant que la concurrence mondiale ne s’y engouffre.
Capitaliser sur la propriété intellectuelle.
La marque, le design, la création numérique et les contenus africains sont les nouveaux atouts compétitifs.
Ils échappent aux barrières tarifaires et renforcent l’autonomie économique.